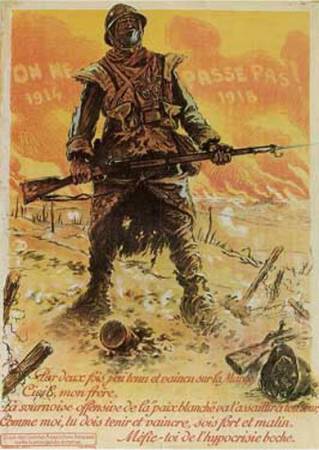11/05/2009
des poulets dans des cages
 «- Chez nous, dis-je [Malaparte], en Europe, seuls les morts comptent.
«- Chez nous, dis-je [Malaparte], en Europe, seuls les morts comptent.
- Je suis las de vivre parmi les morts, dit Jimmy ; je suis content de rentrer chez moi, en Amérique, parmi les hommes vivants. Pourquoi ne viendrais-tu pas, toi aussi, en Amérique ? Tu es un homme vivant, l’Amérique est un pays riche et heureux.
- Je le sais, Jimmy, que l’Amérique est un pays riche et heureux. Mais je ne partirai pas, il faut que je reste ici. Je ne suis pas un lâche, Jimmy. Et puis, la misère, la peur, la faim, l’espérance sont, elles aussi, des choses merveilleuses. Plus merveilleuses que la richesse et le bonheur.
- L’Europe est un tas d’ordures, dit Jimmy, un pauvre pays vaincu. Viens avec nous, l’Amérique est un pays libre.
- Je ne peux pas abandonner mes morts, Jimmy. Vous autres, vous amenez vos morts en Amérique. Il part tous les jours pour l’Amérique des bateaux chargés de morts. Ce sont des morts riches, heureux, libres. Mais mes morts à moi ne peuvent pas se payer un billet pour l’Amérique, ils sont trop pauvres. Ils ne sauront jamais ce qu’est la richesse, le bonheur, la liberté. Ils ont toujours vécu dans l’esclavage ; ils ont toujours souffert de la faim et de la peur. Même morts, ils seront toujours esclaves, ils souffriront toujours de la faim et de la peur. C’est leur destin, Jimmy. Si tu savais que le christ gît parmi eux, parmi ces pauvres morts, est-ce que tu l’abandonnerais ?
- Tu ne voudrais pas me faire croire, dit Jimmy, que le Christ a perdu la guerre ?
- C’est une honte de gagner la guerre, dis-je à voix basse ».
(La Peau, Curzio Malaparte, 1949.)
Ce regard singulier. Du soldat américain victorieux en Europe. Ce n’est pas du mépris mais de la commisération. Pour ces jeunes hommes sains et athlétiques de New York, Cleveland ou Détroit, convaincus d’incarner le Bien et de devoir désormais montrer le chemin à ce vieux continent perclu de massacres et de guerres civiles, l’Europe est un tas d’ordures, un champ de bataille où tout est à reconstruire, en mieux. Ni plus ni moins.
Malaparte montre merveilleusement combien l’âme Européenne se nourrit et vit au travers de cette misère, de ces morts, de cette peur, de la conscience de cette déchéance, que d’autres interprètent comme un avilissement consenti. Et irrémédiable.
Curieux car ce week end, le regard que fait porter Malaparte à son ami américain Jimmy et celui du général Patton, les deux assez peu conventionnels, se sont télescopés. Voici ce que dit Patton durant l’été 1945 pendant son mandat de gouverneur militaire en Allemagne et après avoir vu de prés la réalité de l’Europe (au grand dam de l’Etat major allié et de la presse américaine). Patton ne fut pas chassé de l’armée en raison de ses états de service exceptionnels et grâce à l’amitié et le respect que lui vouait Eisenhower mais il finit quand même par trouver la mort dans un curieux accident de voiture que l’on peut qualifier de suspect sans tomber dans la théorie conspirationniste :
«Je n'ai jamais vu dans aucune armée à aucune époque, y compris dans l'Armée Impériale allemande de 1912, une discipline aussi sévère que celle qui existe dans l'armée russe. Les officiers, sauf quelques exceptions, ont l'apparence de bandits mongols récemment civilisés».
Et aussi : «Je comprend la situation. Leur système [soviétique] de ravitaillement est inadéquat pour les soutenir dans une action sérieuse telle que je pourrais la déclencher contre eux. Ils ont des poulets dans des cages et du bétail sur pied. Voilà leur système de ravitaillement. Ils pourraient probablement tenir le coup pendant cinq jours dans le type de combat que je pourrais leur livrer. Après cela, les millions d'hommes qu'ils ont ne feraient aucune différence, et si vous vouliez Moscou je pourrais vous la donner. Ils ont vécu sur le pays depuis leur arrivée. Il ne reste pas assez pour les ravitailler pendant le retour. Ne leur donnez pas le temps de construire leur système de ravitaillement. Si nous le leur laissons, alors ... nous aurons battu et désarmé les Allemands, mais nous aurons échoué à libérer l'Europe; nous aurons perdu la guerre!»
Ce qu’ils firent. Et nous avec.
Ces deux personnages d’exception, Malaparte et Patton, figurent à merveille le suicide de la civilisation européenne et son remplacement par un idéal horizontal et profondément matérialiste fait d’individualisme rationaliste, de consumérisme effréné, d’universalisme progressiste et arrogant, d’autonomie hédoniste et d’utilitarisme bourgeois justifiant l’arraisonnement de la planète entière sous le masque vertueux des « droits de l’homme » et de la « démocratie libérale » pour tous…
Le dernier mot à Ernst Jünger, guerrier, théoricien de la révolution conservatrice puis contemplatif : « La domination du tiers-état n’a jamais pu toucher en Allemagne à ce noyau le plus intime qui détermine la richesse, la puissance et la plénitude d’une vie. Jetant un regard rétrospectif sur plus d’un siècle d’histoire Allemande, nous pouvons avouer avec fierté que nous avons été de mauvais bourgeois. » (Le travailleur)
Non, l’Europe c’était autre chose. De plus merveilleux que la richesse et le bonheur. Il n'est pas trop tard pour être de mauvais bourgeois.
20:54 | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : américains, soviétiques, europe, malaparte, junger, patton, la peau, allemands, ww2
19/06/2007
Orages d'acier.
« Un cercle d’allemands et d’anglais nous entourait, nous invitant à jeter nos armes. Il régnait la même confusion que sur un navire qui sombre. J’exhortais d’une voix faible mes voisins à poursuivre leur résistance. Ils tiraient sur nos adversaires et sur les notres. Un guirlande de figures hurlantes ou muettes se refermait autour de notre petite troupe ; A gauche deux colosses anglais fourrageaient à coups de baïonnettes dans un bout de tranchée d’ou s ‘élevaient des mains implorantes. Parmi nous, on entendait aussi des voix stridentes : « cela n’a plus de sens ! Jetez vos fusils ! Ne tirez pas camarades ! » Je lançais un coup d’œil aux deux officiers, debout à coté de moi dans la tranchée. Ils me répondirent d’un sourire, d’un haussement d’épaules, et laissèrent glisser à terre leur ceinturons. Il ne me restai plus que le choix entre la captivité ou une balle ; (…) Deux anglais qui ramenaient un groupe de prisonniers du 99éme vers leurs lignes, me barrèrent la route. Je plaquai mon pistolet sur le corps de l’un deux et appuyai sur la détente; l’autre déchargea son fusil sur moi sans m’atteindre ; Ces efforts violents chassaient le sang de mes poumons en spasmes clairs. Je pus respirer plus librement et continuai à courir le long du bout de tranchée. Derrière une traverse, le lieutenant Schläger était accroupi au milieu d’un groupe de tireurs. Ils se joignirent à moi. Quelques anglais, qui traversaient le terrain, s’arrêtèrent, mirent un fusil-mitrailleur en batterie et tirèrent sur nous. Sauf moi-même, Schläger et deux de nos compagnons, tous tombèrent; (…) rien ne m’inquiétait, que la perspective de m’écrouler trop tôt… »
Ces quelques lignes sont tirées d’« Orages d’aciers », livre extraordinaire dans lequel Ernst Jünger relate son expérience de soldat puis d’officier dans les troupes de choc lors de la première guerre mondiale.Qui a lu Barbusse ou Genevoix sait la réalité -l’horreur absolue- de ce conflit. Mais le témoignage d’Ernst Jünger dépasse, à mon avis, le simple récit de guerre et atteint une dimension quasi Homérique, tant l ‘engagement, le courage physique et la fascination sont totales. Jünger fut blessé quatorze fois et fut décoré avant la fin de la guerre de la Blauer Max, la plus haute décoration militaire Allemande. Bien qu’anti-nazi et sympathisant des militaires qui organisèrent l’attentat raté contre Hitler, il sera défendu par celui-ci (qui avait connu aussi l’enfer des tranchées comme simple soldat), en souvenir de sa conduite héroïque durant la première guerre mondiale.
De Jünger, Julien Gracq disait : « L’émail dur et lisse qui semble protéger cette prose contre un toucher trop familier nous semblerait peut-être un peu glacé, si nous ne savions et si nous ne perdions jamais le sentiment au cours de notre lecture, qu’il a été obtenu à l’épreuve du feu. »
Jünger reste une énigme. Né le 28 mars 1895, il s’enfuit à 17 ans de la maison familiale pour s’engager dans la Légion étrangère : « J’avais acquis un jour la certitude que l’Eden perdu se trouvait quelque part dans les ramifications du Nil supérieur et du Congo. » écrit-il dans Jeux Africains. Récupéré par son père à Sidi-bel-abbès, il est engagé volontaire dés le début de la Grande Guerre.Viennent aprés des études de philosophie et de zoologie à Leipzig et à Naples et la publication de ses premiers livres, dont Orages d’aciers, (« Le plus beau livre de guerre que j’ai lu » dit Gide) et Les falaises de marbre, dans lequel il dénonce la barbarie Nazie. Jünger refuse les propositions du parti Nazi en 1933, préférant se consacrer à ses recherches d’entomologistes et à l’écriture. Il participe à la seconde guerre mondiale comme attaché à l’état-major parisien et consacre son temps libre à rédiger son Journal Parisien, de 1939 à 1945. Jünger aime profondément Paris et la France ; on le rencontre à l’hôtel Raphaël ou il loge, au Ritz, à la Tour d’Argent…Il déjeune ou dîne avec Jouhandeau, Morand, Guitry, Arletty, Cocteau, Picasso, Braque…Il lit Melville, Giono et surtout Léon Bloy. Il va au théâtre, se promène à travers Paris. Mais il est témoin aussi d’atrocités et d’horreurs.
« Paris le 7 décembre 1941 ; L’après-midi, à l’Institut Allemand, rue Saint Dominique. Là, entre autres personnes, Merline (Céline), grand, osseux, robuste, un peu lourdaud, mais alerte dans la discussion, ou plutôt dans le monologue. Il y a chez lui, ce regard des maniaques, tourné en dedans qui brille comme au fond d’un trou. (…) Il dit combien il est stupéfait, que nous, soldats, nous ne fusillions pas, ne pendions pas, n’exterminions pas les juifs- il est stupéfait que quelqu’un disposant d’une baïonnette n’en fasse pas un usage illimité. « Si les bolcheviks étaient à Paris, ils vous feraient voir comment on s’y prend ; ils vous montreraient comment on épure la population, quartier par quartier, maison par maison. Si je portais la baïonnette, je saurais ce que j’ai à faire ! » »
« Paris le 7 janvier 1942 ; Reçu une lettre de mon frère Wolfgang qui, de nous quatre a été appelé le dernier sous les drapeaux ; il dirige maintenant, avec le grade de caporal, un camp prisonnier à Zullichau ; les prisonniers ne seront pas mal avec lui. Il me raconte ceci, pour la bizarrerie de la chose : « Hier, je me suis rendu pour raison de service à Sorau en Lusace, ou j’avais à conduire un prisonnier à l’hôpital. Là, il m’a fallut également faire une visite à l’asile d’aliénés. J’y ai vu une femme dont la seule manie était de marmonner sans arrêt : « Heil Hitler ! » Quand même, voilà une folie qui est bien de notre époque. »
Au delà de la description factuelle et érudite de sa vie Parisienne, Jünger révèle au lecteur sa haine de Hitler et de ses partisans (qu’il désigne sous le nom de lémures), son horreur de ce qui s’est emparé de l’Allemagne , mais aussi son impuissance et sa prescience du désastre à venir.
Lors de l’épuration, bien que farouche nationaliste et homme de droite en un certain sens, Jünger sera défendu par Brecht au moment ou son œuvre se voit mise à l’index.
Viennent ensuite des années de voyages, d’études entomologistes et d’écriture qui font de cet homme inclassable un être manifestant dans ses écrits un besoin d’absolu et une exigence de sincérité bien rares.
21:25 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : grande guerre, allemands, armée, nazi, hitler, ernst jünger, épuration